Anna Maria Ortese. La mer ne baigne pas Naples
Il mare non bagna Napoli...
Ce livre de nouvelles et courts récits est sorti en Italie en 1953 et a été traduit en France en 1993 (éditions Gallimard, collection Du monde entier, traducteur Louis Bonalumi). Il vient d’être réédité en français mais je l’ai lu dans la version de 1993.
Evidemment que la mer baigne Naples!
L’auteure veut signifier qu’au sortir de la guerre, une partie de la population a vécu dans une telle misère qu’aucune lumière, au sens propre, ne les atteignait. Les gens vivaient dans des bassi, sorte de grottes, donnant directement sur la rue. Toute une famille élargie, père, mère, enfants, grands-parents, oncles et tantes, cousines, pouvait vivre dans une seule pièce sans fenêtre, sans sanitaire, juste dotée d’une ouverture pour entrer. Le soleil n’arrive que dans les étages élevés, « le reste demeurant livré à l’ombre et aux immondices ».

Entre nouvelles de fiction et « reportages », le livre ne choisit pas vraiment. Si les descriptions sont violemment réalistes, le style est lui plutôt recherché. On a pu dire que « la narratrice, telle un Virgile moderne, nous guide à travers une réalité infernale ».
La crudité des mots met en avant le dénuement absolu dans lequel vivent ces familles, l’arriération mentale qui touche les enfants, les maladies dont tous souffrent à des degrés divers (les enfants ont souvent des problèmes de vue), le manque d’éducation (les enfants ne vont pas à l’école, tous ou presque sont illettrés et d’ailleurs ne parlent pas italien, mais le dialecte napolitain). Il n’y a aucun espoir de sortir de ces sous-sols où sont relégués les plus pauvres.

Ceux qui ont la chance d’habiter les étages plus élevés regardent avec condescendance ces « innombrables fourmis » qui sortent et rentrent « dans des trous, en portant de grosses miettes de pain » (Une paire de lunettes).
Pourtant il en faut peu pour dégringoler à son tour dans les bas-fonds dont on n’a aucune chance de remonter.
Une autre nouvelle (L’or de Forcella) se passe dans un mont-de-piété. La narratrice se faufile dans la très populaire rue Forcella, puis dans San Biagio dei Librai qui « comme d’autres rues, vieilles et très pauvres de Naples, était truffée de boutiques d’achat et de vente d’or ». Le propriétaire du magasin est décrit comme une « larve d’homme » qui guette depuis le seuil de sa boutique « l’apparition d’un visage émacié par les jeûnes ».
Les enfants en très grand nombre, généralement peu vêtus et pieds nus, semblent surgir de « quelque trou au ras du trottoir, pour faire deux ou trois pas, comme un rat et rentrer aussitôt ».

Tout est noir, lépreux, témoigne d’une « misère sans coutours, silencieuse comme une araignée ».
« Ici la mer ne baigne pas Naples. Personne, j’en étais sûre, n’en conservait le souvenir. Dans les ténèbres de cette fosse ne brillait que le feu du sexe, sous le ciel noir du surnaturel ».
Le plus terrible de ces textes est sans aucun doute La ville involontaire.

On se retrouve aux Granili III et IV.
Cet immense bâtiment, près de la mer, avait été construit par Ferdinando Fuga à la fin du XVIIIème siècle pour stocker les céréales et les aliments. 560 mètres de long, 30 mètres de haut sur 4 niveaux et un sous-sol. La façade était percée de nombreuses et hautes fenêtres (87 par étage). 148 pièces sont desservies par de très longs couloirs (plus de 300 mètres). Un escalier aux marches larges et plates permettait aux chevaux de monter leur chargement jusqu’aux étages. Son usage a varié au fil des décennies (arsenal, prison, caserne…).
Après les bombardements intensifs de la Seconde guerre mondiale, beaucoup d’habitants avaient perdu leur logement et sont venus se réfugier dans cette bâtisse insalubre. Ortese décrit l’endroit de manière brutale : il ne s’agit pas de « relogement provisoire de sans-abri mais de la démonstration de la déchéance d’une race ».
3000 personnes pour 570 familles en tout vivent là, donc 20 personnes par pièce en moyenne, nous dit Ortese. Trois à cinq familles peuvent se partager une seule pièce, divisée par du papier d’emballage ou des draps déchirés. Les gens qui vivent là « rampent, grimpent ou trébuchent, c’est leur seule façon de se mouvoir. Ils parlent à peine, ils ne sont plus napolitains, ni n’importe quoi d’autre ». Et elle ajoute, non sans sarcasme : « une commission de religieux et de chercheurs américains qui s’était aventurée avait fait demi-tour au plus vite, le propos incohérent, l’oeil hagard ».
L’auteure explore les lieux en compagnie d’une femme qui vit sur place et dont le nom lui a été donné dans un dispensaire.
Le sentiment d’insécurité et d’horreur est permanent.
L’odeur d’excréments omniprésente, chaque pièce renfermant un grand nombre de pots de chambre.
Il n’y a pas de vitres aux fenêtres, toutes occultées par des planches de bois pour protéger du vent et de la pluie. Pas de meubles, des matelas sur le sol, au milieu des rats. Les enfants, « déjà corrompus par les vices, l’oisiveté, la plus insoutenable des misères, à la fois plein de ruse et de résignation » sont livrés à eux-mêmes, le plus souvent atteints de la tuberculose et de la syphillis et rien ne les protège de la réalité des activités sexuelles des adultes..
Aux 2e et 3e étages, la vie est presque normale. Les gens qui y habitent ont gardé quelque revenu. Ils ont des meubles, un lit, des draps et des armoires. Mais si la vie les oblige à quitter leur logement pour aller plus bas, jamais plus ils ne pourront revenir.
« Regravir les marches, apparemment si commodes, se révélait peu à peu impossible ».
Pour savoir ce qu’était Naples en 1950, il faut lire ce livre terrible plutôt que la quadrilogie romanesque d’Elena Ferrante qui sonne faux d’un bout à l’autre.
La publication de La mer ne baigne pas Naples a fait scandale en Italie, notamment dans les milieux intellectuels, qui ont accusé Anna Maria Ortese de vouloir dénigrer la ville et ses habitants. Malgré le grand succès rencontré par l’ouvrage, Ortese n’est plus jamais revenue à Naples.
Le photographe David Seymour (1911-1956) de l’agence Magnum a fait des reportages après la guerre dans plusieurs pays (Un livre en a été tiré sous le pseudonyme de Chim : Children of War), notamment sur les bassi de Naples.
,
Sur Youtube, on peut voir les rues et les habitants décrits par Ortese. Des extraits (en italien) de son livre rythment le défilé des photos.
La photo en une représente une très jeune prostituée au début des années 1950 dans un centre de redressement.
Tags In
2 Comments
Laisser un commentaire Annuler la réponse.
 Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!
Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!
- Bernard Buffet, le premier amour de Pierre Bergé 29 décembre 2024
- Vous jouez encore à la poupée? 27 décembre 2024
- L’équilibre, c’est quoi pour vous? 13 décembre 2024
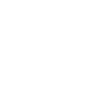

Moins déprimant, plus autobiographique, « L’or de Naples » de Giuseppe Marotta décrit, dans la veine néoréaliste, la vie des « petites gens » qui habitent les bassi et ruelles de Naples. Un bon vieux souvenir de lecture.
Je ne connais pas. J’essaierai de le trouver.